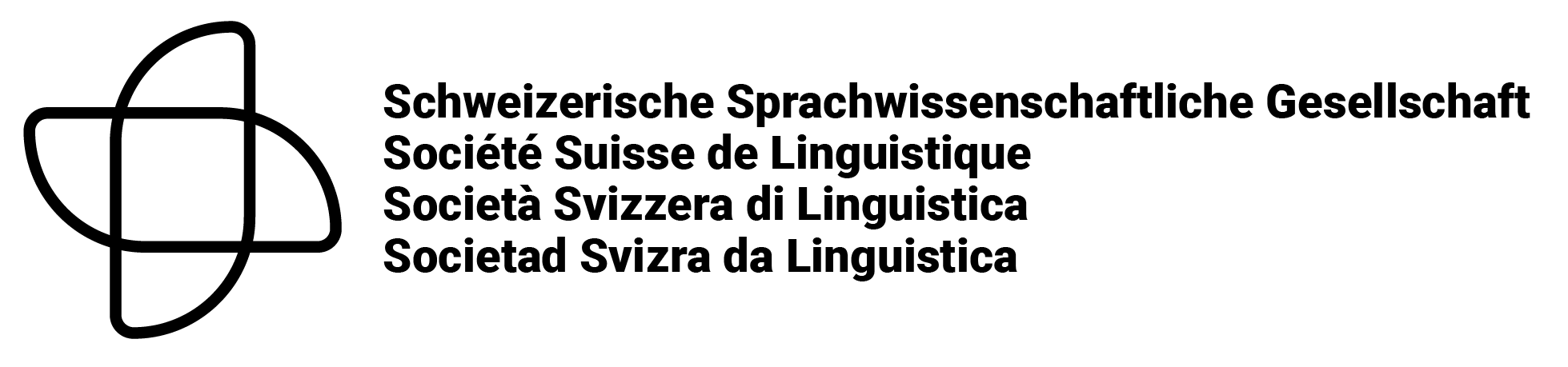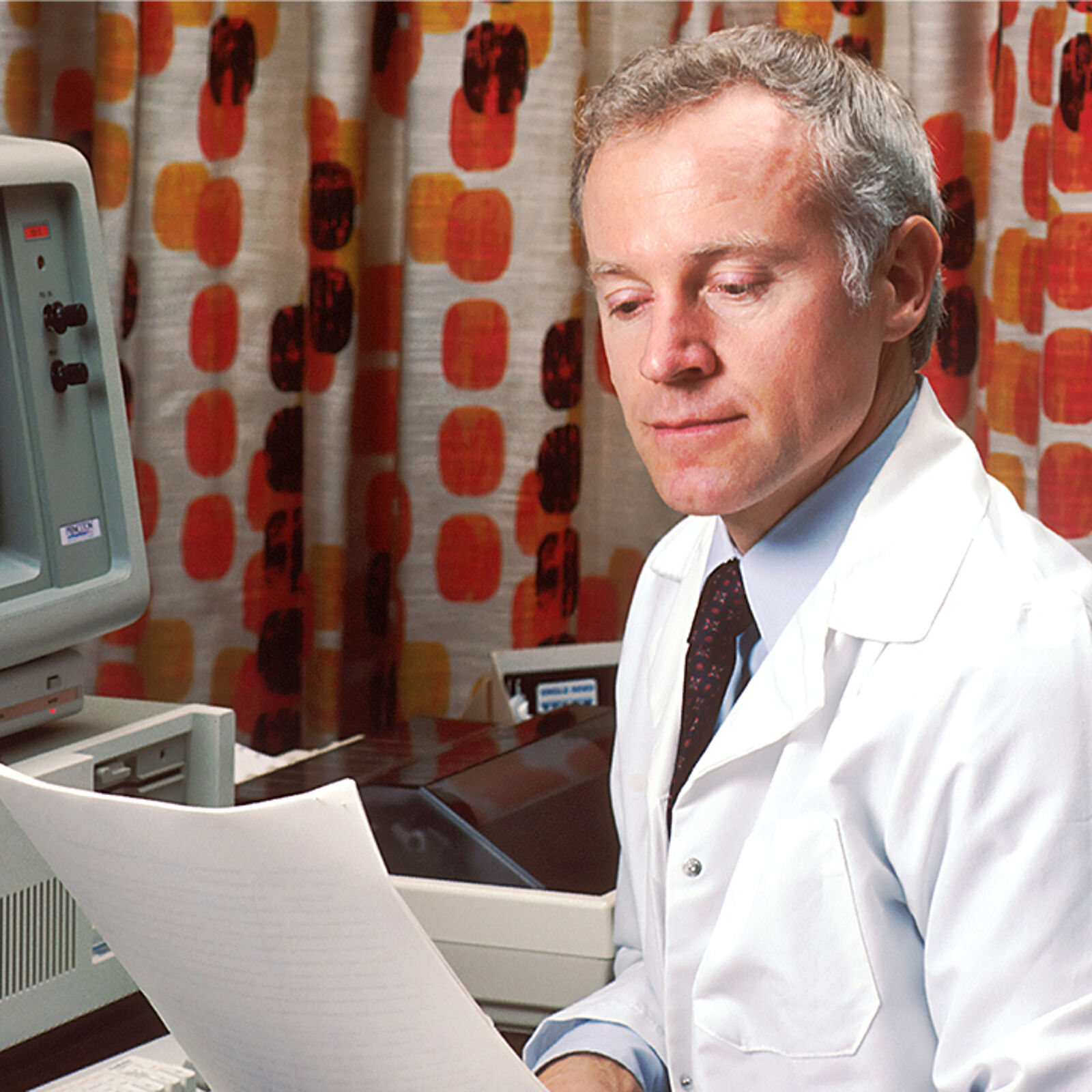De nos jours, le diagnostic de dyslexie est « banal ». Banal parce qu’utilisé par des (non-) professionnel·le·s au quotidien pour qualifier des enfants présentant des difficultés d’apprentissage en français ; banal également parce qu’il s’agit d’un des diagnostics les plus fréquemment attribués par des professionnel·le·s de la santé à des enfants qui dérogent aux normes scolaires ; banal encore, parce qu’il transporte avec lui l’évidence du biologique. Or, si ce diagnostic est aujourd’hui si commun, c’est qu’il a, dans un contexte donné, trouvé une « niche » pour être produit. Préoccupation encore marginale durant le dernier tiers du XIXe siècle, la dyslexie est devenue au cours des décennies qui ont suivi un problème de santé publique. Elle s’est imposée comme une catégorie d’action reconnue des politiques scolaires offrant de nouveaux droits, donnant accès à des mesures individualisées et personnalisées dans le domaine scolaire.
De l’incapacité à lire, au « tournant » congénital
Tandis que le savoir lire et écrire tend à devenir une norme sociale dès le milieu du XIXe siècle, le langage fait simultanément l’objet d’une médicalisation. Plusieurs pionniers – des médecins et des ophtalmologues allemands et anglais en premier lieu – contribuent, avec les progrès de la neurologie et des études anatomopathologiques, à la production de nouveaux savoirs démontrant les origines cérébrales de la lecture et des incapacités lectorales. À la fin du XIXe siècle, la découverte majeure du médecin William Pringle Morgan marque un tournant inédit dans le domaine. Dans un article publié dans le British Medical Journal en 1896, il relate le cas d’un jeune anglais nommé Percy qu’il décrit comme un adolescent brillant et en aucun cas inférieur aux autres jeunes de son âge. Bien que Percy ne présente, selon le médecin britannique, aucune anormalité ni sur le plan biologique ni sur le plan social, celui-ci est pourtant incapable de lire. Pour ce dernier, l’unique déficit de Percy est lié à un écart entre son incapacité à lire et ses autres caractéristiques, et plus particulièrement ses excellentes capacités intellectuelles. Estimant que les difficultés du jeune adolescent sont un cas spécifique, il propose un nouveau diagnostic de « cécité verbale congénitale », porté par une nouvelle étiologie. Ainsi expliquée, l’incapacité à lire n’est plus uniquement due à des lésions cérébrales et ouvre la porte à un nouveau public constitué des enfants scolarisés. Au fil du temps, de nombreuses expressions se succèderont pour qualifier ce type de difficultés pour lesquelles le terme « psycho-médical » consacré aujourd’hui est celui de « dyslexie ».
Distinguer les enfants en « incapacité lectorale » des enfants « faibles d’esprit »
D’importantes études au sujet des difficultés lectorales sont produites à la fin du XIXe siècle tandis que l’accès à l’enseignement primaire se démocratise et que la pratique de la lecture, bien qu’inégalement répandue au sein de la population, s’étend. Dans ce contexte, la médecine est progressivement intégrée aux nouvelles politiques scolaires incitant les professionnel·le·s à examiner et repérer les enfants dits « arriérés » ou « faibles d’esprit » pour les admettre dans des asiles ou des hospices. Durant cette période, les difficultés d’apprentissage en lecture sont peu à peu identifiées au travers de différentes tâches comme la connaissance de l’alphabet, la reconnaissance visuelle des lettres et d’objets ou encore le repérage de mots, sans être encore toutefois quantifiées par des dispositifs standardisés. Ce sont les parents de « bonnes » familles, d’autant plus inquiets de l’échec scolaire de leur enfant que celui-ci est inattendu, qui attirent l’attention du corps médical sur les difficultés de lecture de leurs enfants, qui ne doivent être en aucun cas confondu·e·s avec d’autres dont les difficultés seraient liées à une « forme » de déficience intellectuelle. Seule cette couche aisée de la population a alors accès au diagnostic et au traitement qui lui est associé1.
Mesurer, tester, étalonner : l’objectivation des écarts aux normes de lecture
Il faut attendre les années 1960 et l’extension du mouvement d’ouverture de l’enseignement primaire au secondaire pour que la « dyslexie » se répande. À cette période, des élèves d’origine populaire commencent à fréquenter l’école secondaire, jusque-là réservée à une élite. Or, les compétences lectorales et scripturales de ces élèves ne correspondent pas aux normes du « savoir lire » en vigueur au secondaire. Alors que les attentes au primaire se « limitent » à une bonne oralisation et à une compréhension pragmatique du contenu, celles du secondaire, plus exigeantes, nécessitent une compréhension abstraite des textes et l’articulation de leurs contenus avec des références faisant appel au capital culturel de l’enfant2. Pour faire face à ce public scolaire de plus en plus hétérogène, les différents gouvernements occidentaux activent divers mécanismes de différenciation des élèves. Ils édictent des lois autorisant la création d’écoles et de classes spéciales et convoquent l’expertise (para-)médicale afin d’établir des critères de tri des enfants. Au-delà de la déficience intellectuelle déjà instituée, la dyslexie et d’autres troubles « dys » (dysphasie, dyspraxie, etc.) se répandent3.
À mesure que la nécessité du savoir lire s’étend, la production des savoirs au sujet de la dyslexie croît de façon exponentielle4. Depuis plusieurs décennies déjà, psychologues et pédagogues portent un intérêt pour le développement du langage, sa mesure ainsi que pour l’apprentissage de la lecture. Contrairement à la méthode « clinique » en vogue jusqu’au début du XXe siècle, ces spécialistes s’attachent désormais à produire des tests d’inspiration psychométrique visant à quantifier les (in)capacités lectorales des enfants. Différentes dimensions de la lecture comme la vitesse de la lecture, le degré de correction ou la compréhension sont alors mesurées au travers d’épreuves standardisées et étalonnées. Les tests permettant de mesurer la « bonne lecture » puis, plus tardivement, de diagnostiquer la dyslexie, sont dès lors basés sur une rationalité scientifique qui participe à la production de ce qu’est une « lecture normale ». Ces tests reposent sur un « étalonnage », c’est-à-dire sur des repères chiffrés permettant de comparer un individu à une population de référence à laquelle la personne qui subit le test est censée ressembler. En d’autres termes, ces tests instaurent de nouvelles normes, traduites par un écart statistique entre les compétences de l’élève et les compétences scolaires attendues.
Pour une version « sociale » du diagnostic
L’hypothèse soutenue dans ce texte selon laquelle le diagnostic de dyslexie serait au moins partiellement le produit de la hausse des exigences scolaires et des développements dans le domaine psycho-médical peut être doublée d’une hypothèse offrant une place particulière au rôle joué par les familles de classes aisées. En effet, dans les pays occidentaux et dès le milieu du XXe siècle, certaines familles largement issues de milieux favorisés s’imposent avec plus ou moins de confiance dans l’interpellation des gouvernements en faveur d’une reconnaissance de la dyslexie et de l’obtention de droits particuliers. En s’appuyant sur les savoirs produits par les scientifiques, les associations de parents d’enfants dyslexiques participent à constituer la dyslexie en problème de santé publique5.
Bien que le diagnostic de dyslexie soit le plus fréquemment appréhendé dans sa version « psycho-médicale », une analyse au prisme d’une version « sociale » me paraît ainsi éclairante. En dépassant la seule dimension « biologique » de certaines difficultés lectorales, elle permet d’exposer les conditions sociales, techniques et politiques participant à la production des savoirs forgeant un diagnostic et, plus largement, à la définition de la normalité : d’abord inexistant, puis marginal, le diagnostic de dyslexie s’est banalisé au point d’en devenir « normal ».
Références
[1] Kirby, Philip, Kate Nation, Margaret Snowling & William Whyte (2020): The Problem of Dyslexia: Historical perspectives, in Oxford Review of Education, 46(4), 409‑413. https://doi.org/10.1080/03054985.2020.1770020
[2] Lahire, Bernard (2005) : L’invention de l’illettrisme : Rhé́torique publique, é́thique et stigmates. La Découverte.
[3] Mazereau, Philippe (2006) : Les figures historiques de la « déviance » scolaire entre discours professionnels et savants, in Le français aujourd’hui, n° 152(1), 9‑18. https://doi.org/10.3917/lfa.152.0009
[4] Woollven, Marianne (2012) : La construction du problème social de la dyslexie en France et au Royaume-Uni : Acteurs, institutions et pratiques (de la fin du XIXe au début du XXIe siècle), Université de Lyon.
[5] Ibid.

Auteure
Valérie Angelucci est chargée d’enseignement à la Haute école pédagogique du canton de Vaud. Pour la préparation de sa thèse de doctorat de l’Université de Lausanne, elle s’intéresse aux processus de fabrication du diagnostic de dyslexie, à la croisée des enjeux professionnels, médicaux et scolaires.
Open Access
Cette publication est en accès libre, sous licence CreativeCommons CC BY-SA 4.0.
Disclaimer
Les articles du blog peuvent contenir des opinions exprimées par les auteur·e·s et ne représentent pas nécessairement la position de l'employeur respectif ou de l'ASSH.