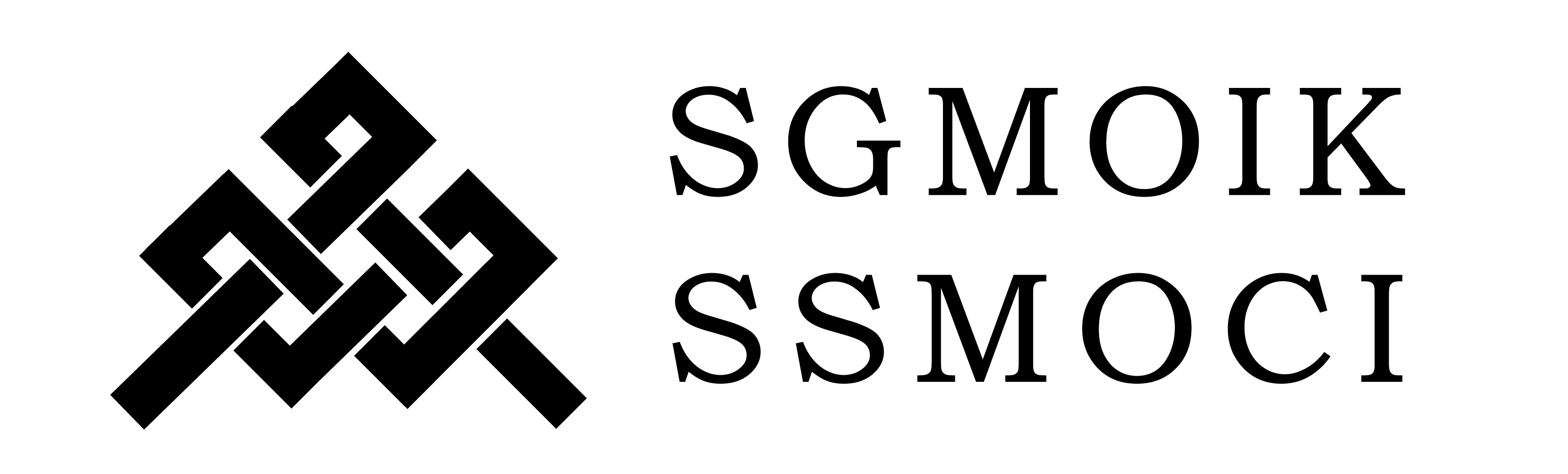La SSMOCI adapte son nom
Lors de la dernière Assemblée générale de la SSMOCI, tenue à Bâle le 16 février 2024, les membres présents ont approuvé à l’unanimité, à l’exception de deux abstentions, une modification du nom de la société dans ses versions française et italienne. Ainsi, les expressions « civilisation islamique » et « civiltà islamica » ont été remplacées par « cultures islamiques » et « culture islamiche », tandis que les versions en allemand et en anglais demeurent inchangées.
Cette décision fait suite à de nombreuses discussions au sein du comité, ainsi qu’à une première consultation des membres lors de l’Assemblée générale de juin 2023. L’objectif de cette révision, bien que modeste, revêt une importance significative : actualiser le nom de notre société pour qu’il reflète les réalités contemporaines, en harmonie avec la vision de la SSMOCI et les perspectives scientifiques et épistémologiques de ses membres.
Importance symbolique du nom
Le choix du nom d’une association revêt une importance symbolique, car il influence la perception qu’en ont ses membres et le public externe, voire sa crédibilité. Ainsi, la réflexion sur la résonance du nom de la SSMOCI était nécessaire ; elle ne pouvait être écartée par la seule crainte de devoir modifier le nom à nouveau dans dix, quinze ou vingt ans.
Une autoréflexion nécessaire
Fondée en 1990, la SSMOCI a vu le jour dans un contexte géopolitique, intellectuel et scientifique très différent de celui que nous connaissons aujourd’hui. Il est donc crucial de réévaluer l’identité et la mission de notre société à la lumière des développements contemporains, tout en gardant un regard critique. En particulier, cela implique de rester en phase avec les recherches et les préoccupations de nos membres, en partant de la réalité de nos activités.
Évolution du sens conféré à « civilisation »
Le terme « civilisation » a connu une évolution sémantique notable ces dernières années, notamment suite à l’émergence des théories du « choc des civilisations ». Cette évolution nous invite à la réflexion. En abandonnant l'expression de « civilisation islamique », la SSMOCI affirme son refus d’une vision simpliste et essentialiste du monde, selon laquelle celui-ci serait divisé en aires ou en civilisations distinctes et homogènes.
De la fondation de la SSMOCI en 1990 au malaise contemporain
La création de la SSMOCI remonte aux débuts des années 1990. A cette époque, de jeunes chercheuses et chercheurs issus du « corps intermédiaire » des universités suisses souhaitent proposer une alternative à la recherche et à l’enseignement disponibles en Suisse sur la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord (MENA) ainsi que sur l’islam. Le comité de la nouvelle société entend promouvoir de nouvelles approches disciplinaires issues des sciences sociales, des area studies, ou encore de la linguistique, tout en encourageant l’émergence d’une recherche axée sur l’époque contemporaine. La SSMOCI se donne alors pour mission de soutenir l’enseignement et la recherche menés en Suisse sur la région MENA et l’islam, de faciliter les échanges entres universitaires et d’encourager la diffusion de leurs travaux.
A l’époque de sa fondation, des discussions animées ont lieu sur le nom de la société, révélant des désaccords sur la désignation de l’espace ou de la région étudiée ainsi que sur la manière d’inclure, ou non, une référence à l’islam. Finalement, les membres optent pour les dénominations « Schweizerische Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen » et « Société Suisse Moyen-Orient et Civilisation islamique ». Il convient de noter qu’à cette période, aucune discussion ne porte sur la traduction anglaise du nom, celle-ci étant introduite ultérieurement avec la généralisation de l’anglais dans les communications du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS).
Dans les premiers temps, le nom de la société ne suscite pas de débats. Au cours des dernières années cependant, il est apparu lors de discussions au sein du comité que plusieurs membres éprouvaient un malaise à l’égard de l’expression « civilisation islamique » en français ou « civiltà islamica » en italien. De même, des remarques et critiques reçues de la part de nouveaux membres sont venues enrichir la discussion.
En 2023, la SSMOCI a réalisé une enquête auprès de ses membres, une occasion pour sonder leur opinion à ce propos. L’enquête a révélé que si 37% des répondants considèrent le nom comme très bon ou acceptable, 44% expriment une aversion ou un malaise à son égard. De plus, si l’on met en relation ces réponses avec les données relatives à la langue maternelle des répondants, il apparaît que les francophones sont bien plus enclins à désapprouver le nom (75%).
« Civilisation » : Évolution du sens
Dans son usage habituel, le terme de « civilisation » renvoie à l’ensemble des caractéristiques sociales, religieuses, morales, esthétiques, scientifiques et techniques d’une société à large échelle. Cependant, il est nécessaire d’examiner brièvement l’évolution de sa signification. Le concept de « civilisation » s’est largement développé au XIXe siècle, sous l’influence d’une idéologie mettant en avant la supériorité européenne, tant vis-à-vis des civilisations précédentes que des civilisations contemporaines perçues comme étrangères. Le terme porte encore aujourd’hui la trace de cet européocentrisme et de l’idée d’une hiérarchie entre les civilisations (Bruneau, 2010).
Mais surtout, le terme a acquis une nouvelle résonance à partir des années 1990, dans le sillage de la publication du livre de Samuel Huntington, Le Choc des civilisations (The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order), paru en 1993. Selon la thèse de Huntington, le monde post-guerre froide ne serait plus divisé selon des lignes idéologiques ou politiques, mais selon des critères culturels et religieux, considérés comme étant le niveau d’identification le plus élevé. Huntington a produit un nouveau découpage du monde en civilisations qui constitueraient des espaces homogènes ou « cohérents » et surtout intrinsèquement incompatibles (Staszak, Fall et Girault, 2017).
Après les attentats du 11 septembre 2001, le concept de « civilisation » a été mobilisé plus que jamais à des fins politiques car il véhiculait l’idée d’une incompatibilité fondamentale ou essentielle entre certaines aires culturelles, en particulier entre l’ « Occident » et l’ « Islam », ou le Moyen-Orient islamique. L’évocation du « choc des civilisations » a servi à justifier la prétendue « guerre contre le terrorisme », voire contre « l’axe du mal », avec les offensives américaines en Afghanistan puis en Irak notamment (Roy, 2002).
Faire le choix d’évoluer
Aujourd’hui, il est devenu impératif de reconsidérer l’usage du terme « civilisation islamique » en raison de la vision réductrice et manichéenne du monde qu’il véhicule. Non seulement le terme présuppose des aires culturelles cohérentes en dissimulant les contradictions internes et la multiplicité des pratiques et des identifications, mais il nie également les échanges et les connexions à la base même de toute culture. C’est d’ailleurs pour ces raisons que le terme de « civilisation » est très peu utilisé aujourd’hui dans les sciences sociales à travers la francophonie.
En outre, le terme de « civilisation » ne correspond pas aux approches privilégiées par les chercheuses et les chercheurs de la SSMOCI qui se penchent sur l’étude de l’islam. Leurs travaux se concentrent plutôt sur l’analyse de pratiques et de processus se déroulant à l’échelle locale ou régionale, explorant les diverses formes et manifestations de l’islam dans le monde, y compris en Suisse. L’islam est abordé davantage comme un phénomène transnational ou multi-situé que comme un élément fondamental d’une aire culturelle.
Dans ce contexte, conserver le terme de « civilisation islamique » reviendrait à maintenir un imaginaire géopolitique à la fois erroné et dangereux. Pour ces raisons, la SSMOCI choisit d’adopter l’expression « cultures islamiques », en français, et « culture islamiche », en italien. Si d’autres associations ont choisi de parler de « mondes musulmans » ou de « sociétés du monde musulman », il nous semble que le terme de « cultures » – utilisé depuis longtemps en anthropologie et géographie culturelles – permet de rendre compte de faits spirituels, intellectuels ou matériels caractérisant des groupes sociaux à une échelle locale. Il se distingue ainsi du terme de « civilisation », qui, tout en désignant de grandes entités, présente une dimension englobante ou homogénéisante. Enfin, la forme plurielle employée en parlant de « cultures » permet de penser la multiplicité des formes et des pratiques de l’islam.
Une réflexion continue
Il est essentiel de reconnaître que la diversité des approches, des sujets d’études et des intérêts des membres de la SSMOCI ne peut être pleinement représentée par une seule désignation. A ce jour, notre société aspire à maintenir une référence à la fois aux études islamiques et aux études aréales (area studies) dans son nom. En d’autres termes, nous souhaitons conserver une formulation qui combine les analyses du point de vue de la région – celle-ci étant nécessairement hétérogène et interconnectée avec d’autres régions – et l’étude de l’islam en tant que phénomène multiforme, transnational et inscrit dans de multiples contextes.
Compte tenu de la constante évolution de nos cadres et référents d’analyse, la SSMOCI est consciente que cet ajustement ne constitue qu’une étape dans un processus continu de réflexion.
Bibliographie succincte
Bruneau, Michel, « Civilisation(s) : pertinence ou résilience d’un terme ou d’un concept en géographie ? », Annales de géographie 2010/4 (n° 674), pp. 315-337.
Mills, Amy et Hammond, Timur. 2016. « The Interdisciplinary Spatial Turn and the Discipline of Geography in Middle East Studies », dans Seteney Shami et Cynthia Miller-Idriss (dir.). From the book Middle East Studies for the New Millennium: Infrastructures of Knowledge. New York, New York University Press : 152‑186.
Roy, Olivier, Les illusions du 11 septembre : le débat stratégique face au terrorisme (Paris : Seuil, 2002).
Schayegh, Cyrus et Casale, Giancarlo, ‘Mobility, Spatial Thinking, and MENA’s Global interconnectivity: a Primary Source Roundtable’, Mashriq & Mahjar: Journal of Middle East Migration Studies, Vol. 9, No. 2 (2022), p. 1-8.
Staszak, Jean-François, Fall, Juliett, et Girault, Frédéric, « Les grands découpages du monde », dans Frontières en tous genres : Cloisonnement spatial et constructions identitaires, sous la direction de J.-F. Staszak (Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2017), pp. 147-168.