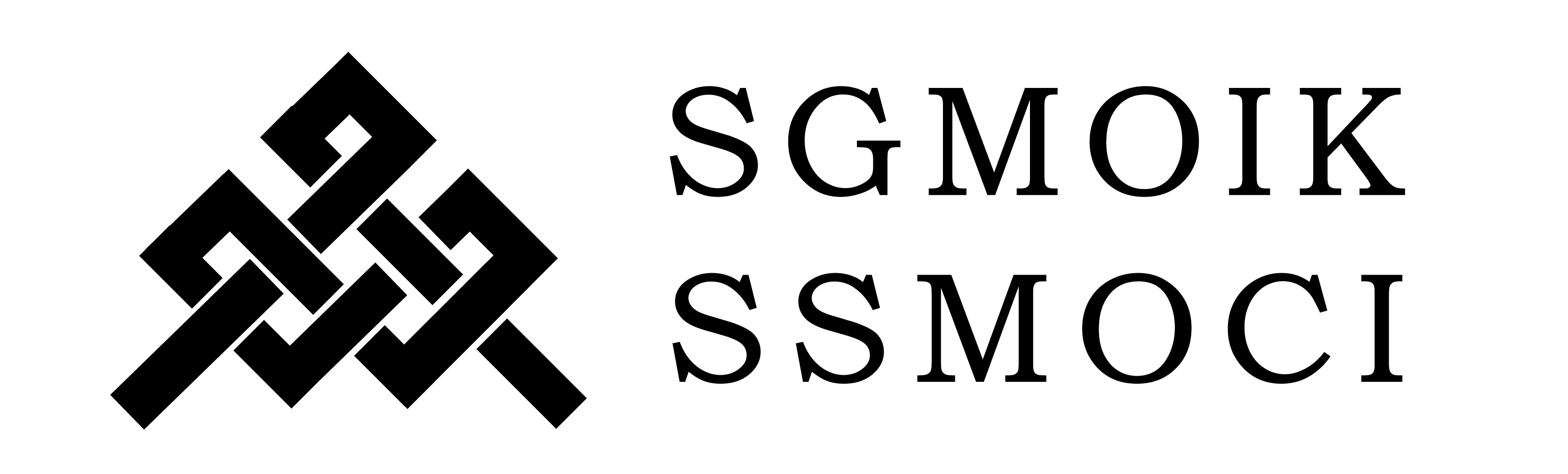Par Falestin Naïli et Valentina Napolitano
Les menaces pleuvent contre la population exsangue de Gaza. Depuis la fin de la première phase de la fragile trêve entre le Hamas et l’État hébreu, intervenue le 1er mars, les négociations sur la deuxième phase sont dans l’impasse et Israël a de nouveau interdit, dès le 2 mars, l’entrée d’aide humanitaire et de produits commerciaux au territoire assiégé. Depuis plusieurs semaines, tant Israël que les Etats-Unis annoncent vouloir s’approprier ce territoire meurtri pour, en ce qui concerne Trump en faire une «Riviera». Cela provoquerait le déplacement forcé vers la Jordanie et l’Égypte des quelque deux millions de Palestiniens ayant survécu à 15 mois d’une offensive israélienne qualifiée de «génocide» par de nombreuses organisations des droits humains.
En attendant, des milliers de déplacés rentrent chez eux, bien souvent en plantant une tente à côté des décombres de leur ancienne maison. Car tout fait défaut dans le territoire occupé. Dans le sillage de l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, durant laquelle plus de 1 200 Israéliens ont été tués et près de 250 pris en otages, les opérations militaires israéliennes ont tué plus de 48 000 personnes et blessé plus de 111 000 autres, selon le ministère de la Santé à Gaza, tandis que 69% des infrastructures ont été endommagées ou détruites, dont 245 000 maisons, selon l’ONU.
Dans ce funeste tableau, le rôle de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA), premier fournisseur d’aide humanitaire pour les Gazaouis, est crucial. L’avenir de l’agence onusienne n’a pourtant jamais été autant en péril, entre son interdiction dans les territoires occupés et le gel de son financement par les Etats-Unis …. et la Suisse.
La Suisse hésite sur fond d’urgence humanitaire
Si la confédération helvétique était le douzième donateur de l’agence en 2023, cette aide a été suspendue en janvier 2024, dans le sillage de l’accusation israélienne selon laquelle 19 des plus de 30 000 employés de l’agence auraient participé aux attaques du Hamas le 7 octobre 2023. L'agence a immédiatement identifié et licencié 10 d'entre eux, tandis que deux autres ont été confirmés morts. A l’époque, la Suisse suivait la démarche adoptée par plusieurs pays de l’Union européenne et les Etats-Unis. Mais après la remise en avril du rapport de l’enquête interne menée par l’ancienne ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, concluant que l’UNRWA «dispose de plus de mécanismes pour assurer sa neutralité que les autres agences onusiennes et qu’elle a un rôle vital pour des millions de personnes», la plupart des pays donateurs recommencent à la soutenir. Seuls les États-Unis et la Suisse maintiennent le gel de leurs fonds.
Après une baisse de 20 à 10 millions en décembre 2023, puis un déblocage ponctuel en mai 2024 au vu de l’urgence humanitaire, la décision finale sur l’avenir de la contribution suisse reste toujours suspendue, malgré plusieurs mois de débats entre le Parlement et le gouvernement suisse. La commission des affaires étrangères du Conseil des États a décidé, dans un vote très serré le 18 février 2025, d’appeler à sa suspension, tel que proposé par le parlementaire UDC David Zuberbühler. Il revient désormais au Sénat de se prononcer lors de la session parlementaire de printemps, qui se tiendra du 26 février au 15 mars.
Entre temps, l’Association suisse des avocat·es pour la Palestine a adressé une lettre aux membres de la commission pour les interpeller sur les conséquences possibles d’une interruption du soutien suisse à l’agence, alertant sur «un risque que la Suisse se rende complice de génocide». Une mise en garde déjà formulée par une note interne du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en février 2024, estimant que la décision de la Suisse de ne plus financer l’UNRWA puisse impliquer «une violation potentielle de ses obligations en matière de prévention et donc une violation de la convention sur le génocide».
La campagne israélienne pour détruire l’UNRWA
Tandis que ces débats se poursuivent en Suisse, le gouvernement israélien mène une attaque sur trois fronts contre l’agence onusienne. D’abord, en ciblant ses infrastructures et son personnel à Gaza. Depuis le 7 octobre 2023, 205 écoles, centres de santé et de distribution ont été bombardés, et 744 déplacés abrités dans ses écoles ainsi que 273 employés de l’agence ont été tués. Ces destructions s’étendent désormais au-delà de l’enclave, les camps de réfugiés en Cisjordanie ayant également été ciblés par l’armée israélienne. En mai 2024, le siège de l’agence à Jérusalem-Est a été contraint à la fermeture après une tentative d’incendie par un groupe de colons israéliens. Le terrain où se situe le siège dans le quartier de Sheikh Jarrah, a par ailleurs été confisqué en octobre 2024 dans le cadre de l’expansion d’une colonie israélienne.
Ces attaques s’accompagnent ensuite d’une campagne de décrédibilisation de l’agence, qualifiée «d’organisation terroriste» par les officiels israéliens, sous le prétexte de sa connivence avec le Hamas. Les récentes accusations de la détention d’une otage israélienne dans une école de l’UNRWA ont été qualifiées de «profondément dérangeantes et choquantes» par le directeur de l’agence, Philippe Lazzarini, qui souligne que l’agence a perdu le contrôle effectif de ses structures à Gaza dès le 13 octobre 2023 en raison de l’offensive militaire israélienne.
Sur le terrain légal enfin, deux lois controversées ont été votées le 28 octobre dernier par la Knesset pour interdire dès fin janvier 2025 les activités de l’UNRWA à Jérusalem-Est, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Le premier texte de loi voté en octobre 2024 interdit les actions menées par l’agence dans les territoires israéliens, y compris Jérusalem-Est (qui a été annexée en violation du droit international). Le second rend illégal tout contact entre les autorités étatiques israéliennes et l’agence, ce qui empêcherait toute coordination entre l’agence et l’administration militaire israélienne qui contrôle les territoires occupés. En tant que puissance occupante, Israël est pourtant tenu de garantir l’accès à l’aide humanitaire dans ces territoires, en vertu des Conventions de Genève de 1949.
Dès le 4 novembre 2024, Israël avait officiellement informé l’ONU de son intention de rompre ses liens avec l’UNRWA. Une décision confortée, le lendemain, par la victoire à l’élection présidentielle américaine de Donald Trump, soutien constant de Benyamin Netanyahou et détracteur virulent de l’agence onusienne depuis son premier mandat. Ces lois sont rentrées en vigueur le 30 janvier, date à laquelle le quartier général de l’agence à Jérusalem est resté fermé pour la première fois, malgré l’opposition de nombreuses personnalités et organisations.
En parallèle à ce travail de sape, Israël dit espérer que d’autres agences onusiennes et organisations internationales « non politisées et plus efficaces » prendront le relais. Or les organisations internationales parfois citées comme alternatives possibles à l’UNRWA, telles que le CICR et Médecins sans frontières, ont clairement indiqué qu’elles ne se substitueraient pas à l’agence onusienne.
Tel-Aviv préconise aussi l’intervention d’organismes privés, peu conformes aux principes de neutralité et d’indépendance, pour distribuer l’aide humanitaire à Gaza. En promouvant la création de «bulles humanitaires» ou de «gated communities » supervisées par des forces armées, potentiellement des forces spéciales britanniques à la retraite, selon The Guardian, cette proposition transformerait de fait l’enclave en camp d’internement.
La fin des opérations de l’agence onusienne, très active à Gaza, notamment en matière de vaccinations contre la poliomyélite (polio) et de coordination de l’aide arrivant au compte-gouttes avant la trêve, aurait des conséquences humaines dramatiques. Tout spécialement dans cette enclave assiégée où la situation sanitaire et humanitaire est qualifiée de «catastrophique» par l’Organisation mondiale de la Santé. Dès janvier 2024, une ordonnance de la Cour internationale de justice (CIJ) avait déjà évoqué à cet égard le « risque de génocide ».
En Cisjordanie où trois camps de réfugiés ont été dépeuplés de force par l’armée israélienne depuis le début de l’année, la situation est désormais également critique pour les plus de 40 000 déplacés.
La disparition du droit au retour?
Mais au-delà de l’aide humanitaire, l’attaque en règle de Tel-Aviv est surtout d’ordre politique. Elle vise à se débarrasser de cette agence qui, en 75 ans d’existence, n’a cessé de rappeler à Israël ses responsabilités dans la création du problème des réfugiés ainsi que les violations du droit international liées à sa politique expansionniste.
Car si au moment de sa création, l’action de l’agence avait été conçue comme neutre et apolitique, elle s’est inévitablement politisée. Trouver une solution politique pour mettre fin au conflit israélo-palestinien était initialement du ressort de la Commission de conciliation des Nations unies pour la Palestine (UNCCP) qui termina ses travaux à la fin des années 1950. Depuis, l’UNRWA est devenue le seul organisme de l’ONU fournissant aux Palestiniens des services quasi étatiques, mais elle ne leur accorde pas pour autant une protection politique internationale.
En effet, les Palestiniens sont exclus du système de protection établi par la Convention de Genève sur le statut des réfugiés de 1951. Le caractère politique de l’agence est dû au fait qu’elle matérialise la responsabilité de la communauté internationale à l’égard des réfugiés palestiniens, qui la considèrent comme la garante de leur droit au retour.
Théoriquement, son mandat aurait pu prendre fin avec une résolution politique, comme celle qui était attendue des accords d’Oslo de 1993. Pendant la période de négociations ouverte par la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d’autonomie (Oslo I), plusieurs dossiers épineux – dont celui des réfugiés palestiniens – avaient été reportés à la phase dite du « statut final », ostensiblement afin de ne pas compromettre l’ensemble des discussions.
Pour les Palestiniens, l’horizon d’attente ouvert par ce dossier ne concernait pas seulement le retour des réfugiés, mais aussi la création d’un État palestinien aux côtés d’un État israélien dans les frontières de 1967. Après la création d’un tel État, l’Autorité palestinienne (AP) aurait repris les responsabilités de l’UNRWA dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Un plan de transfert des services était ainsi prévu par le «Programme pour la mise en œuvre de la paix» afin d’améliorer les conditions de vie dans les camps de réfugiés et d’assurer le développement économique des territoires palestiniens.
Mais le processus d’Oslo échoue, en grande partie en raison de la poursuite de la colonisation illégale des territoires palestiniens par Israël. De quoi entraîner le retour de la prééminence du cadre juridique établi par les résolutions de l’ONU, comme l’a récemment rappelé la Cour Internationale de Justice (CIJ) dans une de ses décisions. D’après cette dernière, le droit international prime sur les négociations, y compris celles d’Oslo, et l’occupation israélienne des territoires occupés en 1967, déclarée illégale, doit prendre fin dans les 12 mois suivant la résolution du 18 septembre 2024 de l’Assemblée générale des Nations unies.
L’UNRWA constitue dès lors, par sa simple existence et par son action constante, un rappel permanent du droit international auquel Israël devrait se conformer. De sorte que son élimination permettrait à Tel-Aviv de mettre à distance la question du droit au retour des réfugiés.
Tandis que le terme de «crise humanitaire» est devenue une expression consensuelle pour décrire la situation catastrophique sévissant dans la bande de Gaza, les deux lois votées par la Knesset entendent éradiquer le principal acteur capable d’y répondre. Ainsi, après la marginalisation de la question politique des droits des réfugiés palestiniens, cette détérioration programmée de leurs conditions de vie fait peser le risque, de plus en plus réel, d’annihiler leur existence même.
Ce texte est adapté d’un article publié le 7 novembre dans The Conversation
|
L’UNRWA a été créée en 1949 pour fournir une aide d’urgence à près de 800 000 réfugiés palestiniens. Son mandat initial vise à améliorer leurs conditions de vie, jusqu’au règlement juste de leur situation, fondé sur la résolution 194 (III) votée le 11 décembre 1948 qui établit leur droit au retour et à des compensations. Soumis à un renouvellement triennal, ce mandat s’est pérennisé du fait de la non-résolution du problème. Dans ses cinq aires d’intervention (Jordanie, Liban, Syrie, Gaza et Cisjordanie), l’UNRWA est devenue, pour quelque 6 millions de personnes, un pourvoyeur majeur de services essentiels (éducation, santé, logement). Elle entretient les infrastructures de 58 camps où elle gère 706 écoles accueillant un demi-million d’élèves, 140 dispensaires médicaux de base et 113 centres communautaires, et accompagne également 475 projets de microfinance. L’UNRWA est en outre, après les services publics des pays hôtes, le premier employeur de la région avec près de 30 000 employés dont la majorité sont des Palestiniens. Elle possède aussi des millions de documents d’archives (à Gaza et à Amman) qui constituent une source historique exceptionnelle, notamment sur la question des réfugiés. |
Valentina Napolitano, sociologue et chargée de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (IRD). Elle est spécialiste des questions migratoires et des conflits au Moyen-Orient.
Falestin Naïli, historienne, professeure assistante à l’Université de Bâle et chercheure associée à l’Institut français du Proche-Orient. Elle est spécialiste de l’histoire contemporaine de la Palestine et de la Jordanie et dirige actuellement le projet FNS Consolidator «Futures Interrupted: social pluralism and political imaginairies beyond coloniality and the nation-state».
Littérature Complémentaire
Al Husseini, Jalal, 2003, “L’UNRWA et les réfugiés : enjeux humanitaires, intérêts nationaux”, Revue d'études palestiniennes, N° 86(1), pp. 71-85, https://www.palquest.org/sites/default/files/LUNRWA_et_les_refugies_Enjeux_humanitaires_interets_nationaux.pdf
Bocco, Riccardo, 2009, “UNRWA and the Palestinian Refugees: A History within history”, Refugee Survey Quarterly, Vol. 28, Nos 2-3, pp. 229–252, https://academic.oup.com/rsq/article/28/2-3/229/1584825
Irfan, Anne, 2020, “Palestine at the UN: The PLO and UNRWA in the 1970s”, Journal of Palestine Studies, Vol. XLIX, No. 2 (Winter), pp. 26-47, https://www.palestine-studies.org/en/node/1649968
Jerusalem Quarterly, Issue 93-4, UNRWA Archives (Part 1-2), guest edited by Francesca Biancani & Maria Chiara Rioli
https://www.palestine-studies.org/en/node/1653824
https://www.palestine-studies.org/en/node/1654236