Par Asmaa Dehbi et Noemi Trucco
« Tu verras, quand tu seras plus grande, toi aussi on te forcera à mettre le voile ! » – « Retournez dans votre pays, vous n’avez rien à faire ici. » – « Espèce de vilain, salopard arabe, retourne chez toi pour baiser avec tes camarades parasites fascistes, sous-humains, palestiniens, nous ne voulons plus de vous en Europe, partez. »
Ces trois témoignages sont représentatifs de ce que les personnes musulmanes ou les personnes perçues comme musulmanes vivent régulièrement en Suisse. Les trois personnes concernées que nous citons ici nous ont fait part de leurs expériences dans le cadre d’une étude sur le racisme antimusulman ou – dans le cas du troisième exemple – sous la forme d’un e-mail.
Il s’agit de la toute première étude de la Confédération sur le racisme antimusulman. Elle a été réalisée par le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) sur mandat du Service de lutte contre le racisme (SLR). Pour cette étude, nous avons mené des entretiens avec dix-sept personnes concernées et avons interrogé une trentaine d’expert·es issu·es d’organismes spécialisés, d’administrations, d’organisations musulmanes et d’universités. De plus, nous avons analysé plus de 200 publications scientifiques.
Le constat est sans appel : les expériences de racisme antimusulman ne sont pas des cas isolés. Ce type de racisme est largement répandu et se manifeste dans presque tous les domaines de la vie quotidienne.
Pourtant, ce sujet reste largement ignoré par l’opinion publique. Même les actes graves contre des personnes musulmanes ne reçoivent qu’une faible couverture médiatique. Qu’il s’agisse de l’attentat contre une mosquée en 2016 ou de l’agression antimusulmane survenue à Bad Ragaz en 2024, les médias ont soit passé ces événements sous silence, soit présentés ces crimes comme des incidents isolés.
Qu’entend-on par racisme antimusulman?
Le racisme antimusulman présente « l’Occident » et « l’Islam » comme opposés et incompatibles. Ce schéma rappelle d’autres formes de racisme : une population est construite comme étant « autre » en raison de sa culture, de sa religion ou de son origine présumée, dans une hiérarchie implicite qui dépeint les « autres » comme arriérés, fanatiques religieux, violents, sexistes ou hostiles à la démocratie. L’e-mail de haine cité plus haut illustre de manière frappante comment les personnes musulmanes sont dévalorisées et même déshumanisées dans ce processus.
Ce phénomène ne touche pas uniquement les personnes musulmanes, mais aussi celles perçues comme musulmanes en raison de leur nom, de leur origine ou de leur apparence, même si elles n’adhèrent pas à la foi islamique.
Parallèlement, toutes les personnes musulmanes ne sont pas touchées de la même manière par la discrimination et la violence : celles qui sont perçues comme « clairement musulmanes » sont particulièrement concernées – par exemple, parce qu’elles portent un voile ou une longue barbe. Le voile, en particulier, sert souvent de point d’ancrage au racisme et à la discrimination : « On sait toujours ce que je suis », nous a confié une personne interrogée.
L’émergence du racisme antimusulman est étroitement liée à l’histoire coloniale européenne. La théorie la plus importante à ce sujet a été développée dans les années 1970 par Edward Saïd, théoricien américano-palestinien de la littérature, dans son ouvrage L’Orientalisme. Par ce concept, Saïd désigne le regard européen porté sur l’Asie du Sud-Ouest et l’Afrique du Nord à travers l’art, la littérature et la science.
L’orientalisme – et, par extension, le racisme antimusulman – remplit deux fonctions : il construit l’ « Orient » comme un miroir contrastant à l’image que l’Europe se fait d’elle-même. L’Europe est ainsi perçue comme progressiste, démocratique et égalitaire en matière de genre, tandis que l’ « Orient » est présenté comme arriéré, antidémocratique et discriminatoire en matière de genre.
Cette image stéréotypée est projetée sur les personnes musulmanes et sert de justification à leur discrimination. On leur dénie l’appartenance à la société majoritaire et on leur complique, voire empêche, l’accès à des sphères essentielles de la vie sociale.
Un exemple subtil se trouve dans le message du Conseil fédéral relatif à l’initiative sur l’interdiction de se dissimuler le visage en 2021. Il y est écrit que le port du voile peut relever du libre choix d’une personne – par exemple dans le cas de Suissesses converties. En attribuant explicitement la liberté de choix aux seules Suissesses converties, le Conseil fédéral renforce implicitement l’image décrite plus haut : toutes les autres musulmanes qui portent un voile ne feraient donc par un choix libre, mais y seraient contraintes.
Cet exemple montre comment les débats politiques et médiatiques en Suisse s’inscrivent dans des représentations héritées du colonialisme. En particulier, les débats autour de l’initiative sur l’interdiction des minarets de 2009 ont grandement contribué à ce que l’opinion publique considère les personnes musulmanes comme un problème.
Les discussions portent plus souvent sur les personnes musulmanes, au lieu de s’engager dans un dialogue avec elles. En fin de compte, selon cette représentation, les musulman·es seraient extra-européens, étrangers et donc « autres ». Le racisme antimusulman s’inscrit ainsi dans les divers récits de « surpopulation étrangère » qui existent depuis longtemps en Suisse : contre les personnes juives, les communistes et les travailleur·euses immigré·es.
Une caractéristique spécifique du racisme antimusulman est qu’il se présente souvent sous la forme d’un récit de menace. Une étude commandée par la Commission fédérale contre le racisme a révélé qu’en 2017, un article de presse sur deux consacré à l’islam et aux personnes musulmanes traitait des thèmes de la radicalisation et du terrorisme. Cela construit l’image des personnes musulmanes comme un risque pour la sécurité. Ainsi, l’une des personnes que nous avons interrogées témoigne : « On m’insulte d’être terroriste ».
Les personnes musulmanes sont placées sous un soupçon généralisé, alors que la présomption d’innocence prévaut pour la majorité de la société. Le récit de la menace sert de justification et conduit à la normalisation du racisme antimusulman. En arrière-plan subsiste l’idée implicite que la discrimination à l’encontre des personnes musulmanes serait, d’une certaine manière, justifiée.
Il n’est donc pas surprenant que, selon l’Office fédéral de la statistique, près de 35% des personnes musulmanes de Suisse déclarent avoir été victimes de discrimination raciale. Le chiffre réel est probablement bien plus élevé. Toutes les personnes que nous avons interrogées ont rapporté avoir été confrontées à des actes de racisme à plusieurs reprises et dans des situations quotidiennes variées. Nous ne leur avons pas spécifiquement posé des questions sur les domaines de vie concernés, mais nous les avons identifiés à partir des entretiens enregistrés et transcris.
Le racisme antimusulman dans le système éducatif suisse
Dans les écoles, les jardins d’enfants ou les universités, le racisme antimusulman semble être largement répandu. Toutes les personnes interrogées ont rapporté avoir vécu des situations racistes dans le système éducatif : que ce soit dans leur parcours scolaire ou universitaire actuel, dans leur passé ou à travers l’expérience de leurs enfants. Cependant, il n’existe pas d’études approfondies qui analysent systématiquement ce phénomène.
Une telle documentation serait pourtant essentielle, car le racisme dans le système éducatif est hautement problématique et peut avoir des conséquences considérables pour les personnes concernées. Par exemple, lorsque des enseignant·es évaluent leurs élèves à un niveau de performance inférieur, attendent moins d’elles et eux que des autres et, par conséquent, les encouragent moins à fournir de bonnes prestations. Un témoignage illustre cette situation : « Le professeur a dit : ‹ Dans la mesure où l’allemand n’est pas votre langue maternelle, je serais déjà satisfait si vous obteniez un 4 › et je lui ai répondu : ‹ Eh bien pas moi ! › »
De telles assignations identitaires ne sont pas sans conséquences. Ils influencent les recommandations de carrière et l’attribution des notes. La sociologie de l’éducation parle ici de « l’effet d’origine » : une situation où les décisions des enseignant·es sont prises indépendamment des performances réelles des élèves.
Certes, l’influence concrète des enseignant·es sur les recommandations d’orientation varie selon les cantons. Cependant, les témoignages recueillis auprès des personnes interrogées et des expert·es révèlent des expériences similaires à travers le pays : par exemple, le fait que les personnes musulmanes ou perçues comme telles se voient souvent conseiller un apprentissage, même lorsque leurs résultats leur permettraient d’accéder au gymnase (lycée ou collège).
Dans les récits des personnes concernées, on retrouve souvent « cet·te enseignant·e » dont dépendait largement leur parcours scolaire. Cette personne a, selon les cas, soutenu leur ascension scolaire ou bien tenté de l’entraver. Une personne interrogée raconte qu’un·e enseignant·e lui a dit : « Si je veux, je peux te mettre une mauvaise note à l’oral, et alors tu ne réussiras pas. »
Cela rejoint les conclusions de diverses études qui démontrent que l’idéal d’égalité des chances n’est pas pleinement réalisé dans le système éducatif suisse. Les opportunités de formation restent socialement inégalement réparties et dépendent encore de critères étrangers à la performance, comme l’origine sociale, le contexte migratoire ou le genre. Le racisme entre également en ligne de compte.
Les enseignant·es attribuent également fréquemment aux élèves musulman·es des caractéristiques immuables et ancrées « dans leur culture » – alimentant ainsi l’idée que « l’islam » et les personnes musulmanes seraient arriérés, patriarcaux et antidémocratiques.
Lou, une jeune musulmane, nous a raconté comment un·e enseignante a réagi lorsqu’elle est arrivée pour la première fois au gymnase avec un voile. L’enseignant·e a demandé à Lou de sortir, puis, devant la porte, lui a dit : « Je voulais juste te dire : tu n’arriveras à rien comme ça dans la vie. Je ne sais pas ce que ton père t’a dit, mais peut-être que tu pourras y réfléchir un peu (au sujet du voile) ».
Nous ne connaissons bien sûr pas les intentions exactes derrière ce propos. L’enseignant·e a peut-être voulu suggérer que Lou compromettait sa réussite future dans son parcours scolaire et professionnel en portant le voile. Ou alors, il ou elle craignait que Lou soit discriminée à cause de celui-ci et qu’elle ne réussisse pas.
La première explication reflète plutôt des stéréotypes individuels, tandis que la seconde fait porter sur l’individu la responsabilité d’une discrimination structurelle. Dans les deux cas, cependant, la remarque est discriminatoire : en supposant que la décision de Lou ait été influencée par son père, l’enseignant·e alimente le stéréotype de rapports familiaux et de genre patriarcaux.
Racisme antimusulman sur le lieu de travail
Sur le marché du travail également, les personnes concernées témoignent de racisme antimusulman. Là encore, ce racisme a des conséquences profondes : à commencer par la difficulté même de trouver un emploi, lorsque des discriminations injustifiées surviennent lors du processus de recrutement. Il peut se manifester sous forme de harcèlement au travail (mobbing), de discrimination salariale ou de licenciements discriminatoires.
Les femmes portant le voile sont particulièrement exposées à des discriminations lors du processus de recrutement. En 2020, Nathalie Gasser, de la Haute école pédagogique de Berne, a ainsi démontré qu’en Suisse, même avec d’excellents certificats, il reste difficile pour les femmes portant le voile de décrocher une place d’apprentissage.
On retrouve le même schéma bien au-delà des places d’apprentissages. Certaines pharmacies, hôpitaux et même certains magasins – comme l’a révélé un cas rendu public chez Coop – stipulent dans leurs contrats de travail que les employées ne doivent pas porter le voile. Le canton de Genève connaît même, avec sa loi sur la laïcité, une interdiction du voile pour les employées de l’Etat. Lorsque les femmes portant le voile ne parviennent pas à trouver un emploi en Suisse, il arrive apparemment fréquemment que les offices régionaux de placement (ORP) leur conseillent de postuler sans photo ou même sans voile. C’est ce qu’a rapporté une personne interrogée, mais c’est aussi ce que montre un article du journal du syndicat UNIA, publié le 16 juin 2023.
Ce sont des exemples parlants de discrimination intersectionnelle. L’intersectionnalité signifie que différentes formes de discrimination se recoupent et interagissent. Le voile articule deux caractéristiques : le fait d’être une femme et d’être musulmane. L’imbrication de ces deux caractéristiques entraîne d’autres formes de discrimination. En effet, seules les femmes musulmanes sont concernées par l’interdiction du voile.
Les stéréotypes et les discriminations se produisent également sur le lieu de travail. Ainsi, une personne concernée travaillant dans le secteur de la santé s’est vu demander par un patient s’il utilisait également des couverts dans son pays d’origine. De telles questions peuvent sembler innocentes à première vue. Pourtant, de nombreuses personnes concernées se sentent dévalorisées par ce processus de othering (construction de l’altérité) : « Cette question du ‹ vous › et du ‹ nous › revient toujours à dire : ‹ Tu n’es pas des nôtres › », dit une personne interrogée.
Une personne portant le voile a été victime de discrimination sur son ancien lieu de travail. Face à cette situation, elle a décidé d’engager une procédure pour harcèlement (mobbing) et de démissionner. Elle raconte : « Ils m’ont dit très franchement : ‹ Tu es compétente, c’est tout ›. Ils voulaient dire que je maîtrise bien la langue, que je suis bonne dans mon domaine. ‹ Si ce n’était pas le cas, tu n’aurais rien à faire ici en tant que personne d’origine musulmane › ».
Racisme antimusulman dans le domaine de la santé
Dans le secteur de la santé, de nombreuses personnes concernées perçoivent les expériences de discrimination comme particulièrement graves. En tant que patient·e, que ce soit chez un·e médecin ou à l’hôpital, on se trouve dans une situation de vulnérabilité accrue par rapport à d’autres contextes. En effet, on est dépendant de l’évaluation et des recommandations des médecins. Or, ce qui est en jeu est fondamental : sa propre santé. Cela peut intensifier le vécu de la discrimination.
Les médecins et les psychologues attribuent souvent aux femmes musulmanes la virginité ou des structures familiales patriarcales. Lorsqu’une femme musulmane exprime, par exemple, des troubles gynécologiques, les professionnel·les de la santé les attribuent parfois à une appartenance à l’ « islam ». C’est le cas, par exemple, lorsque le vaginisme – à savoir, la crispation et la contraction du plancher pelvien et de la musculature vaginale – est associé à des conceptions prétendument conservatrices de la sexualité.
Cela peut entraîner une prise en charge insuffisante : les médecins risquent de ne pas prendre au sérieux les plaintes des patientes, de ne pas rechercher les causes médicales sous-jacentes et, par conséquent, de ne pas fournir le traitement médical nécessaire.
Le système de santé suisse est également marqué par des stéréotypes liés à la perception de la douleur, similaires à ceux observés aux États-Unis chez les personnes noires. Des études montrent que les médecins leur attribuent souvent une sensibilité à la douleur plus marquée, ce qui conduit à une prise en charge insuffisante de leurs douleurs.
Une personne concernée nous a confié : « Dans l’accès aux soins, il faut des fois se battre un peu. Parce que typiquement, il y a des préjugés comme quoi les femmes musulmanes se plaindraient plus au niveau des douleurs, des choses comme ça. Il y a un an et demi, j’ai fait une appendicite. Et je devais me battre pour avoir de la morphine et tout à coup je pars au scanner et là, ils voient que ça ne va pas du tout, et là, c’est eux qui sont toutes les deux minutes en train de me donner de la morphine. »
Réfléchir aux structures, élargir les connaissances et créer des espaces protégés
Les discriminations racistes dans les domaines de l’éducation, du travail et de la santé, mais aussi des administrations et de la police, ne sont pas des cas isolés. Elles témoignent du caractère systémique du racisme antimusulman dans des domaines centraux de la vie quotidienne.
Les établissements éducatifs, les employeurs et employeuses, le domaine de la santé et les institutions publiques ont donc une responsabilité particulière : celle d’interroger leurs propres structures au regard du racisme antimusulman. Dans ces espaces en particulier, il est important que les membres de ces institutions approfondissent leurs connaissances sur le racisme et prennent conscience de leurs propres implications dans des formes de discrimination structurelles et intersectionnelles.
Pour cela, les institutions publiques comme privées devraient développer des offres de formations critiques vis-à-vis du racisme et les intégrer durablement dans leur quotidien. En plus de mesures préventives, il est nécessaire de développer des stratégies d’identification et d’intervention. Pour les personnes concernées, il est crucial de se sentir en sécurité afin de pouvoir exprimer librement leurs expériences, leurs incertitudes et leurs besoins. Les jeunes, en particulier, ont besoin d’« espaces protégés » : des lieux où ils et elles peuvent s’exprimer et s’épanouir face à la polarisation croissante des débats publics.
Cet article est une traduction de l'article original en allemand.
*
Vous trouverez l’étude complète ici : Trucco, Noemi, Dehbi, Asmaa, Dziri, Amir et Hansjörg Schmid (2025). Racisme antimusulman en Suisse : étude de référence. SZIG/CSIS-Studies 13. Fribourg : Centre Suisse Islam et Société.
Asmaa Dehbi a étudié les sciences de l’éducation ainsi que le programme « Islam et société » aux universités de Zurich et de Fribourg. Elle est doctorante et assistante scientifique au Centre Suisse Islam et Société (CSIS) de l’Université de Fribourg. Ses travaux portent sur le travail social dans les sociétés traversées par les migrations, la professionnalité socio-pédagogique et le racisme antimusulman.
Noemi Trucco a étudié la sociologie et les études du Moyen-Orient (Middle Eastern studies) aux universités de Berne et de Fribourg. Elle a obtenu un doctorat en sociologie sur la subjectivation des imams et est chercheuse associée au Centre Suisse Islam et Société (CSIS) de l’Université de Fribourg. Ses recherches portent sur la sociologie de la connaissance, l’analyse du discours et l’étude des processus de subjectivation. Dans son travail, elle s’intéresse aux musulman·es et à l’islam en Europe, aux processus d’altérisation (Othering) et d’exclusion, à l’apatridie, aux conflits sociaux et aux inégalités sociales.
Littérature complémentaire
Bundesamt für Statistik (2020). Religiöse und spirituelle Praktiken und Glaubensformen in der Schweiz. Erste Ergebnisse der Erhebung zur Sprache, Religion und Kultur 2019. Neuchâtel: BFS.
Ettinger, Patrik (2018). Qualität der Berichterstattung über Muslime in der Schweiz. Bern: Eidgenössische Kommission gegen Rassismus EKR.
Gasser, Nathalie (2020). Islam, Gender, Intersektionalität. Bildungswege junger Frauen in der Schweiz. Bielefeld: transcript.
humanrights.ch und EKR (2024). Rassismusvorfälle aus der Beratungsarbeit 2023. Bericht zu rassistischer Diskriminierung in der Schweiz auf der Grundlage des Dokumentations-Systems Rassismus DoSyRa. Bern: humanrights.ch und EKR. https://www.network-racism.ch/rassismusberichte/rassismusvorfalle-in-der-beratungpraxis-2023.
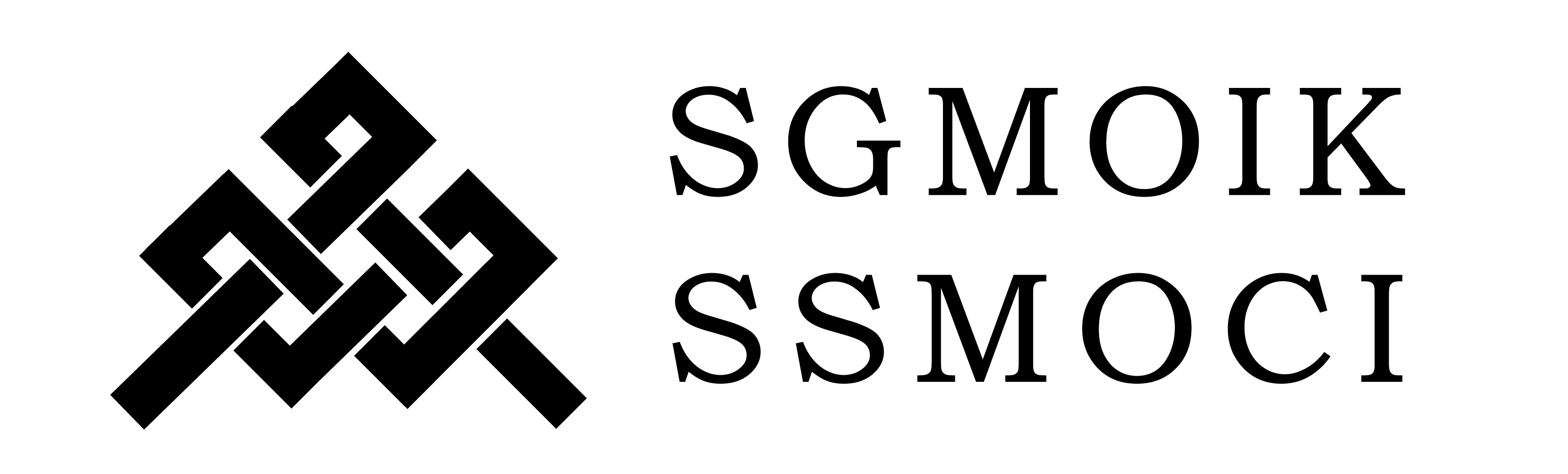

Sei der erste der kommentiert