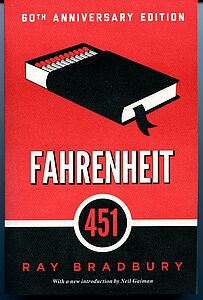Outre les multiples péripéties sanitaires qui ont secoué le quotidien des Suissesses et des Suisses (mais aussi, et c’est suffisamment rare pour être mentionné, celui des habitants du monde entier), l’année 2020 s’est démarquée par la fréquente apparition dans les médias helvétiques d’un terme qui, jusqu’alors, demeurait encore peu connu : la dystopie. En effet, les modifications de notre société à l’ère de la COVID-19 et les mesures envisagées pour enrayer la propagation de la pandémie ont parfois été comparées aux caractéristiques du monde de 1984 – le célèbre roman de George Orwell, publié en 1949 – ou à celles des Furtifs, le bestseller d’Alain Damasio, paru en 2019.
Or, il est évident pour tout chercheur que le terme de dystopie, provenant initialement de la théorie des genres littéraires, est la plupart du temps mal utilisé, puisqu’il semble désigner, sous la plume de journalistes peu enclins à vérifier leurs sources, tout récit de fiction à l’issue tragique : un récit de fin du monde serait dystopique, au même titre que les récits décrivant une société totalitaire. Pourtant, et en se rappelant, à la suite de la Poétique d’Aristote, que la fiction est par essence le récit d’une catastrophe imaginaire, toutes les fictions, selon la grille de lecture adoptée par les médias en 2020, seraient des dystopies ! Une telle grille de lecture est donc problématique et doit être abandonnée, à condition de vouloir saisir avec rigueur ce qu’est une dystopie et à quoi ces récits peuvent bien « servir ».
Des mondes parfaitement… cauchemardesques
Définir la dystopie suppose tout d’abord de comprendre les liens qu’elle tisse avec l’utopie. Ce dernier genre littéraire – dont la naissance est traditionnellement attribuée au texte de Thomas More, Utopia, publié en 1516 – décrit le voyage imaginaire d’un individu vers un non-lieu (u-topos) dans lequel les êtres humains seraient heureux (eu-topos) suite à l’actualisation de réformes sociopolitiques. Ces dernières, bien évidemment inédites eu égard au contexte sociohistorique qui entoure la rédaction du récit, ont pour fonction de mettre en lumière les problématiques de ce même contexte : si Thomas More fait de son Utopia une île où règne la communauté des biens, c’est pour critiquer les conséquences néfastes – criminalité, brigandage, etc. – du régime de la propriété privée, actif dans l’Angleterre du XVIe siècle.
Pour le dire autrement, les utopies, d’une part, réfléchissent aux conséquences négatives sur l’être humain d’une organisation sociale donnée en inventant un monde dans lequel cette organisation a été modifiée et, d’autre part, montrent que le bonheur humain est fonction de cette organisation. Pourtant, et Thomas More lui-même ne s’y est pas trompé, les utopies ne sont pas des programmatiques : elles ne sont pas des projets à réaliser, mais des « rêves » – des fictions, donc – qui peignent le portrait, peu glorieux, des déviances de nos sociétés. L’utopie est par conséquent un miroir à la fois heuristique – elle nous aide à le penser – et herméneutique – elle en propose une interprétation – de notre monde ; elle est un outil symbolique grâce auquel nous pouvons réfléchir différemment à notre être-au-monde et au quotidien dans lequel nous sommes trop souvent englués.
Or, une des propriétés des utopies – en particulier parce qu’elles sont des systèmes de signes extrêmement cohérents –, c’est qu’elles peuvent être renversées : la loi idéale peut être vue comme bénéfique mais aussi comme maléfique ; l’île isolée peut protéger mais aussi enfermer. Et c’est justement lorsqu’on renverse une utopie qu’apparaît son inverse : la dystopie. Plus concrètement, la dystopie est une utopie. En effet, toutes deux possèdent les mêmes attributs, toutes deux sont construites de la même manière ; mais alors que l’utopie décrit de l’extérieur les avantages d’une réforme sociopolitique qui sert de contrepoint à l’organisation qui a cours dans le monde réel, la dystopie préfère raconter de l’intérieur les impacts de cette réforme sur les individus humains. Cette divergence du mode de raconter est connue – l’utopie est descriptive, la dystopie est narrative –, mais elle n’est pas souvent exploitée dans ses multiples ramifications. Pourtant, à condition d’aller un peu plus loin, il appert que si l’utopie est une dystopie, et que la dystopie raconte l’existence d’un individu de l’intérieur, alors la dystopie est une façon particulièrement efficace de raconter l’utopie.
Pourquoi raconter nos utopies ?
Nous pouvons dorénavant saisir la fonction anthropologique des récits dystopiques : ils n’anticipent pas le futur ni ne nous disent vers quoi nous tendons. Ils ne sont pas des récits d’avertissement – qui a changé ses comportements à la lecture d’un roman ? – ni des récits tragiques. Les dystopies sont avant tout des dispositifs textuels ou filmiques qui visent à dévoiler, par l’immersion dans un ailleurs fictionnel, les problématiques de… nos utopies. Et si elles le font, c’est bien parce que les utopies sont, aujourd’hui (mais pas hier), actives dans notre quotidien. Ne vivons-nous en effet pas dans une société irriguée d’idéologies à tendance utopique ? Ne cherchons-nous pas le confort à tout prix ? la santé ? la sécurité ? la croissance économique ? la consommation ? le progrès technologique ? Mais que sacrifions-nous pour atteindre de tels objectifs ? Quel est le prix – humain – à payer ? Toutes ces questions, et bien d’autres encore que je vous épargne pour ne pas alourdir mon propos, sont délicates à résoudre, car il nous est difficile de prendre de la distance vis-à-vis des modèles structurants qui conditionnent notre agir et notre pensée.
Et c’est là où la fiction (dystopique), en raison d’une de ses propriétés fondamentales consistant à nous inviter à adopter un autre point de vue que le nôtre, a un rôle non négligeable à jouer : elle nous plonge dans les tourments d’un individu qui nous ressemble, elle nous fait éprouver ses émotions lorsqu’il se rend compte de l’aliénation cachée derrière les idéologies qu’il acceptait passivement, elle nous invite à penser nos impensés, c’est-à-dire toutes ces utopies qui informent notre existence. Voilà pourquoi la dystopie est toujours en lien avec l’ici et maintenant, voilà pourquoi la dystopie nous parle toujours du présent : 1984 de George Orwell évoque implicitement l’utopie du Basic English – une réforme linguistique en vogue dans les années 1940 – et des dangers qu’il y aurait à limiter le vocabulaire ; La Kallocaïne de Karin Boye (1947) rappelle à quel point la confiance ne peut s’accommoder de la transparence ; Fahrenheit 451 de Ray Bradbury (1953) critique l’apparition des mass media et la standardisation de la pensée qu’ils induisent ; V pour Vendetta (Alan Moore et David Llyod, 1982-1988) pointe les effets délétères d’une recherche béate du confort ; Les Furtifs d’Alain Damasio attaque avec virulence l’immobilisme qui surgit de toute société numérique…
Refuser l’aveuglement
Les titres pourraient être multipliés, la conclusion serait toujours la même : la dystopie nous parle de notre monde et des utopies qui y siègent, discrètement. Ou, plutôt, elle nous montre comment la valeur fondamentale des sociétés démocratiques – la liberté – peut être mise à mal par la volonté, compréhensible mais nocive, de réaliser l’idéal. Autrement dit, la dystopie est une littérature typique de la modernité, cette modernité qui s’est subsumée à des idéaux de perfectibilité ; elle est un mouvement de révolte, un mouvement qui, par l’entremise du récit de fiction, nous pousse dans nos retranchements en nous incitant à voir ce que nous n’aimons pas voir – que les vertus de nos utopies ne peuvent que conduire à un nouvel obscurantisme. Non plus celui du dogmatisme religieux, mais du dogmatisme dans lequel nous sommes enferrés : celui de réaliser, sur Terre, le paradis. Un tel désir risque bien d’être la cause non de notre salut, mais de notre perdition. Ce n’est pas pour rien que Thomas More (1516), à la toute fin de son utopie, affirme:
ce pays [utopien], je le souhaite plutôt que je ne l’espère
L’humaniste anglais avait bien compris le rôle de l’utopie – nous proposer de penser autrement le présent – et les risques, si on espérait réaliser l’utopie, de la voir se transformer dans son inverse, la dystopie. Voici la leçon de l’utopie, voici une leçon qui, aujourd’hui, devrait résonner avec notre actualité : nous ne devons pas lire ou visionner ces récits pour appréhender notre avenir, mais pour rester en mouvement face à tous ces idéaux qui, c’est presque leur définition commune, ne peuvent que séquestrer notre liberté dans les beautés illusoires de la perfection.

Autor
Auteur: Marc Atallah
Maître d’enseignement et de recherche à la section de français de l’Université de Lausanne et Directeur de la Maison d’Ailleurs
Copyright: Il s'agit d'une publication en libre accès sous la licence CreativeCommons Attribution CC BY 4.0.