Par Mathilde Sigalas
Lors de son voyage « historique » en Irak en mars 2021, au milieu du désert foulé cent ans plus tôt par des archéologues occidentaux pressés de confirmer les textes bibliques, le pape François s’est dit « à la maison » au sein du site antique d’Ur, considéré comme le lieu où Abraham reçut l’appel de Dieu, entama son voyage et « devint père d’une famille de peuples ».
Or l’affiliation de ce site du sud de l’Irak au père de tous les croyants a longtemps été débattue dans les sphères scientifiques et médiatiques depuis son exploration archéologique dans les années 1920. Financées par des institutions privées cherchant à prouver la véracité de l’Ancien Testament, ces expéditions ont entraîné dans leur sillage une exportation du patrimoine qui a nourri la volonté des Irakiens de se revendiquer, eux aussi, « à la maison ».
Car le pillage du patrimoine irakien n’a pas commencé avec les G.I. lors de l’invasion américaine en 2003, ni avec les djihadistes iconoclastes de l’organisation État islamique (EI) lors de la prise de Mossoul en 2014. Dès le XIXe siècle, la Mésopotamie a vu un flux continu d’archéologues et de voyageurs repartir avec son patrimoine pour alimenter collections privées et musées occidentaux. Paradoxalement, ce sont des scandales de spoliation dans les années 1920 qui vont révéler l’importance de leur patrimoine aux Irakiens, lesquels se battent depuis pour en récupérer les artefacts éparpillés aux quatre coins du monde.
Ur et les enjeux de l’archéologie biblique
Le site archéologique d’Ur est repéré dès 1854 sous le nom de Tell al-Muqayyar par le consul britannique en poste à Bassora, John J. Taylor, et le naturaliste W. Kenneth Loftus. Ce n’est qu’après la Première Guerre mondiale que le British Museum décide d’envoyer une mission de reconnaissance sur le territoire irakien et les premières antiquités découvertes confirment le potentiel historique du lieu. Le British Museum s’associe avec un musée états-unien, l’University Museum (aujourd’hui Penn Museum) à Philadelphie, et montent ensemble une expédition qui se renouvèle consécutivement pendant douze années, de 1922 à 1934. Les premières saisons offrent des résultats scientifiques encourageants, mais les fouilles connaissent un véritable tournant à partir de 1926-1927 avec l’excavation du cimetière royal d’Ur. Le chantier est propulsé sur le devant de la scène médiatique, faisant concurrence à la tombe de Toutankhamon en Égypte, révélée quelques années auparavant.
La presse s’empare du caractère biblique des découvertes, qui est réaffirmé en 1929 lorsque Léonard Woolley, directeur du chantier, déclare avoir trouvé la trace du déluge qui a engendré le mythe de l’Arche de Noé. Cependant, aucun outil ou méthode n’étaient en mesure de confirmer les interprétations faites par les archéologues. Plusieurs années après, la modernisation des techniques de fouilles a révélé que la crue n’était pas celle racontée dans l’Ancien Testament, mais seulement un événement climatique dont l’inondation avait fortement touché la région du sud de l’Irak dans l’Antiquité.
Pourquoi un tel empressement à l’interprétation biblique des découvertes, aux dépens de la rigueur scientifique ? Contrairement au reste de l’Europe continentale où la recherche archéologique était soutenue par des institutions publiques, aux États-Unis et au Royaume-Uni, les créanciers étaient principalement des acteurs privés, particuliers, mécènes ou fondations philanthropiques, désireux de financer une mission en terre biblique et de confirmer les textes religieux par des traces matérielles.
Les archéologues avaient donc tout intérêt à effectuer des rapprochements entre leurs découvertes et la religion judéo-chrétienne afin de s’assurer le renouvèlement des donations pour leurs expéditions et avoir la possibilité de poursuivre leurs chantiers. Comme le montre l’exemple d’Ur, les missions archéologiques étaient généralement associées à des universités et des musées. Ces institutions ont également contribué à la ferveur religieuse, veillant à la satisfaction des financeurs et de l’opinion publique à travers l’exposition des antiquités exportées depuis le Moyen-Orient, en leur attribuant une signification ou une légende en lien avec la Bible.
Archéologues et contrebandiers
À l’époque, la loi sur les antiquités éditée en 1924 stipule qu’à l’issue d’une saison de fouilles, l’ensemble des objets découverts est divisé en deux lots entre le département des antiquités irakien et le directeur du chantier, la moitié des objets recevant une autorisation pour être exportés. Officieusement, la loi a mis plusieurs années à être approuvée, car les avantages espérés des occidentaux d’obtenir un grand nombre d’objets se sont confrontés aux ambitions nationales des Irakiens. Afin d’éviter de voir se reproduire certaines exactions du XIXe siècle, les permis de fouilles sont délivrés uniquement à des archéologues connus parmi les sphères universitaires et avec une expérience de terrain.
Pour maximiser leur chance d’obtenir le droit de fouiller, les institutions occidentales — principalement allemandes, britanniques, états-uniennes et françaises — décident de monter des expéditions conjointes. Mais au fil des années 1920, leur présence et l’exportation d’une partie des antiquités découvertes sont de plus en plus critiquées dans la presse irakienne. Les premiers soupçons portent sur l’authenticité et la valeur des objets des lots destinés au Musée national de Bagdad. Certains représentants irakiens en viennent à penser que, lorsque les antiquités sont envoyées dans les musées européens et états-uniens pour des restaurations ou des reproductions, ce sont les doubles qui leur reviennent. La situation se tend davantage lorsque l’ancien directeur du département des antiquités, R.S. Cooke (1926-1929), se retrouve impliqué dans une tentative de spoliation d’objets.
En avril 1930, un transporteur routier est arrêté dans le désert au poste douanier de Ramadi sur l’itinéraire entre Bagdad et Beyrouth pour un contrôle de routine. Avant de repartir, le chauffeur précise aux gardes-frontières qu’un paquet lui a été remis plusieurs jours auparavant par R.S. Cooke, lui demandant qu’il soit distribué dans un lieu précis à Beyrouth, mais qu’il n’en a pas vérifié le contenu. Les douaniers découvrent que le paquet renferme des antiquités non déclarées sur le point d’être exportées clandestinement d’Irak. À Bagdad, l’affaire fait scandale, d’autant plus que R.S. Cooke était en pleine connaissance des lois, les ayant supposément appliquées en tant que directeur du département des antiquités quelques années auparavant. Pire, le destinataire du paquet à Beyrouth n’est autre que l’archéologue états-unien R.F.S. Starr, directeur de l’expédition de Nuzi en Irak, menée par l’Université d’Harvard et l’American School of Oriental Research (ASOR).
Reconnu coupable au terme d’une enquête ouverte par les autorités, R.S. Cooke doit quitter le pays dès le mois de mai. Le cas de R.F.S. Starr prend lui plusieurs mois à être traité. En décembre 1930, l’issue du scandale n’est toujours pas rendue officielle, mais la presse annonce que R.F.S. Starr demeurera directeur du chantier de Nuzi pour la saison suivante, ce qui apparait comme une présomption d’innocence de son implication dans l’exportation illégale d’antiquités.
Un fragment du patrimoine récupéré
L’exportation et, parfois, la spoliation d’artefacts engendrent une prise de conscience par la population irakienne de la valeur de son patrimoine. D’autant qu’il commence à être exposé, aussi, à Bagdad. Au début des années 1920, les lots d’antiquités destinés à l’Irak étaient entreposés dans les bâtiments des autorités mandataires, mais la quantité d’objets en vient rapidement à occuper trop d’espace. Gertrude Bell, directrice du département des antiquités de 1922 à 1926, monte le projet d’établir un musée, qui voit le jour en 1926, et conserve dès lors l’ensemble des antiquités découvertes qui lui sont attribuées. Des expositions temporaires y sont organisées chaque année, afin que la population puisse observer les richesses du sol irakien et l’intérêt de préserver ces objets. Le tourisme se développe progressivement avec la visite de sites archéologiques et des conférences sont organisées pour présenter les découvertes et résultats les plus récents.
Après l’indépendance de l’Irak le 3 octobre 1932, une révision de la loi sur les antiquités de 1924 est entamée par les autorités irakiennes, avec une limitation stricte concernant l’exportation d’objets. Les missions britanniques et françaises se retirent pour aller fouiller en Syrie, où la division des lots est encore de moitié. Les archéologues allemands et états-uniens poursuivent leurs excavations, mais négocient au moment de la division des antiquités pour tenter d’obtenir un lot représentatif de leurs travaux. En 1934, le premier directeur irakien, Sati al-Husri, est nommé à la tête du département des antiquités. En 1936, la nouvelle loi sur les antiquités est ratifiée. Bien qu’amendée à plusieurs reprises depuis, elle demeure la référence en matière de législation en Irak aujourd’hui.
Les collections du musée national irakien se sont imposées durant la seconde moitié du XXe siècle comme parmi les plus riches en artefacts des époques assyriennes, babyloniennes et sumériennes, renforçant le discours et le prestige national chez les habitants. Las, durant les premières décennies du XXIe siècle, ces collections ont été systématiquement détruites et pillées à la suite de l’invasion américaine, puis de celle de l’EI dans le nord du pays.
Dans le sillage de la deuxième guerre du Golfe, des milliers d’objets ont été retournés ou déclarés officiellement à l’étranger et pouvant être rapatriés. D’autres ont été volontairement spoliés ou feints d’être détruits puis revendus sur internet, et leur trace est désormais difficile à retrouver. Plusieurs musées et organisations internationales coopèrent pour tenter d’intercepter des antiquités dès qu’il y a un doute sur leur provenance et leur éventuel statut d’objet spolié. En septembre 2020, la police britannique, aidée par les experts du British Museum, a empêché la vente aux enchères d’une plaque sumérienne d’environ 4 400 ans et a annoncé son rapatriement vers l’Irak. Un fragment parmi les milliers d’objets spoliés que les Irakiens cherchent à récupérer. Car si l’urgence est à la lutte politique dénoncée dans la rue de Bagdad à Bassora, après quatre décennies de guerres et de division, le lent chemin de la reconstruction de l’Irak repose aussi sur la réappropriation de son passé. Signe d’espoir, en novembre 2020, sept ans après les pertes causées par l’EI dans la région, le musée de Mossoul a rouvert ses portes au public en affirmant que l’héritage et les antiquités représentaient une part de l’identité de la ville et de ses habitants.
Mathilde Sigalas est doctorante en histoire contemporaine à l’Université de Genève, Suisse. Son projet de thèse se concentre sur la circulation des antiquités entre le Moyen-Orient et les États-Unis des années 1920 aux années 1950, dans le cadre du projet FNS intitulé «Rockefeller Fellows as Heralds of Globalization: the circulation of elites, knowledge, and practices of modernization (1920s-1970s)».
Cet article a été publié en collaboration avec Orient XXI.
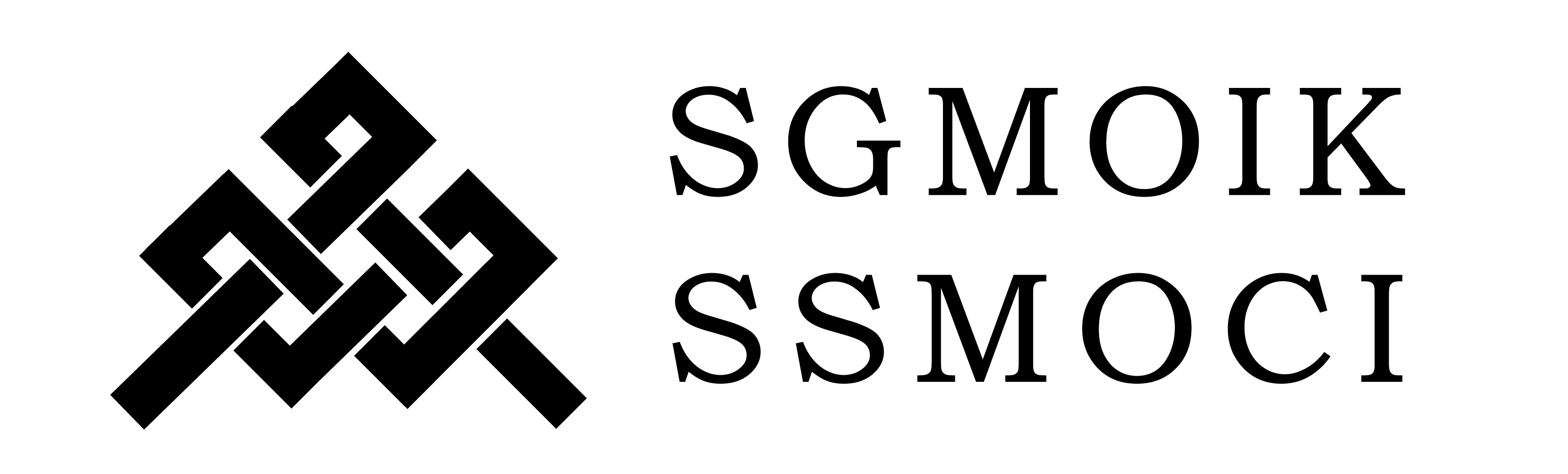

Sei der erste der kommentiert